Date(s)
du 13 mars 2025
au 15 mars 2025
Jeudi, de 9h30 à 18h, Université Paris Nanterre (Salle des conférences)
Vendredi, de 9h15 à 18h, Université Paris Sorbonne ("Salle de la Fresque")
Samedi, de 9h15 à 13h, Campus Condorcet (Salle de séminaire 50, Centre des colloques)
Type(s) d'évènements
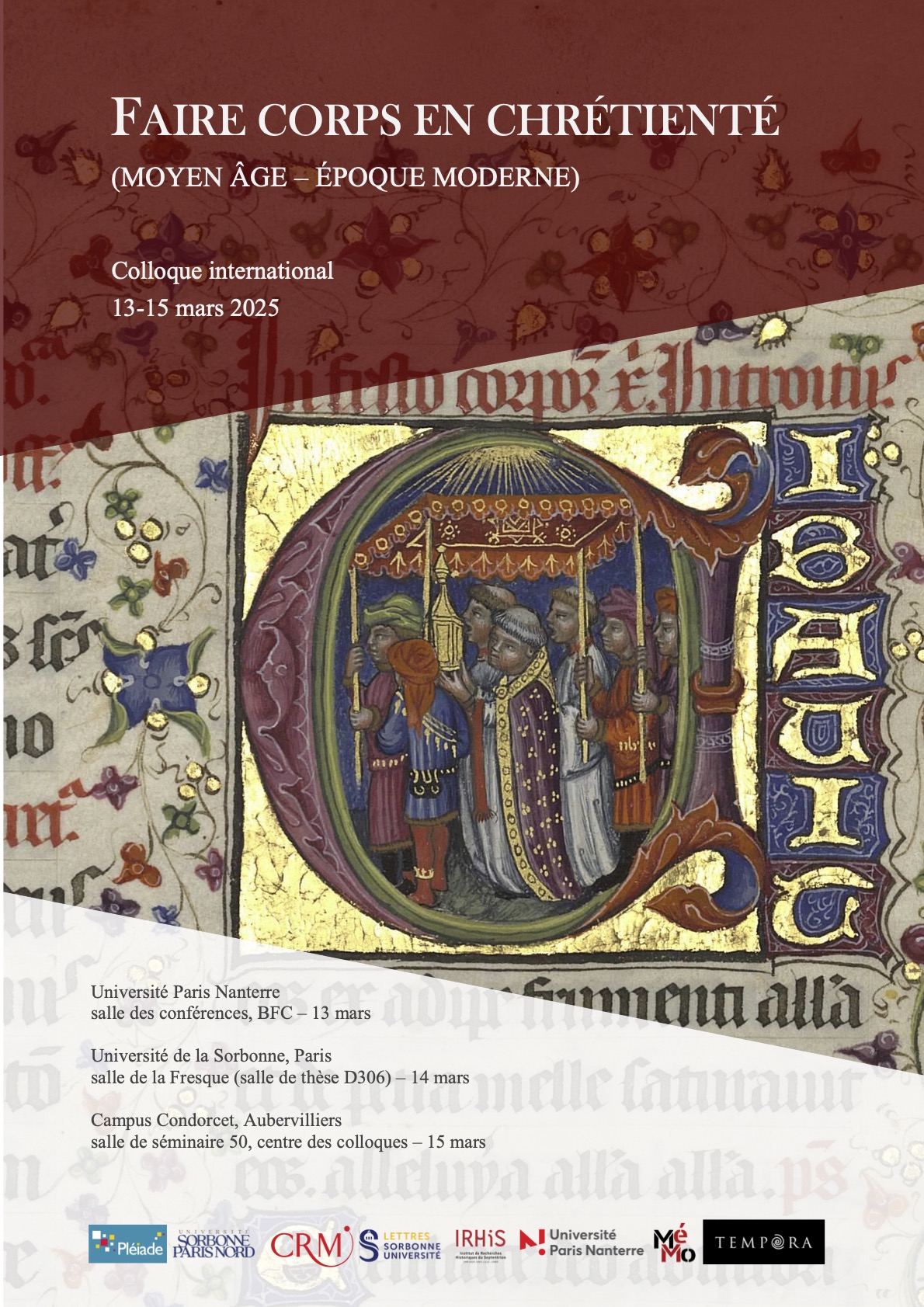 Dans sa première épître aux Corinthiens, l’apôtre Paul avait adopté la métaphore du corps pour évoquer la diversité des charismes et des fonctions au sein de la communauté chrétienne : tous membres de l’unique corps du Christ, les croyants ont chacun leur place et leur utilité, selon le don propre reçu de Dieu. La métaphore organiciste a par la suite été souvent reprise, avec les principes qu’elle véhiculait : indivisibilité, complémentarité et interdépendance, hiérarchie. Elle a en outre été appliquée à l’Ecclesia comprise au sens large, le corps religieux mais aussi social et politique. Ce schéma général n’excluait pas l’existence de « corps intermédiaires » : communautés et ordres religieux, chapitres, confréries, confraternités de prière… À côté de ces corps institutionnalisés et définis par le droit, de quelle reconnaissance ou sentiment d’appartenance étaient accompagnés des groupes et communautés plus informels, tels, entre autres, les romieux et jacquets cheminant vers leur destination ou revenus d’un même pèlerinage ?
Dans sa première épître aux Corinthiens, l’apôtre Paul avait adopté la métaphore du corps pour évoquer la diversité des charismes et des fonctions au sein de la communauté chrétienne : tous membres de l’unique corps du Christ, les croyants ont chacun leur place et leur utilité, selon le don propre reçu de Dieu. La métaphore organiciste a par la suite été souvent reprise, avec les principes qu’elle véhiculait : indivisibilité, complémentarité et interdépendance, hiérarchie. Elle a en outre été appliquée à l’Ecclesia comprise au sens large, le corps religieux mais aussi social et politique. Ce schéma général n’excluait pas l’existence de « corps intermédiaires » : communautés et ordres religieux, chapitres, confréries, confraternités de prière… À côté de ces corps institutionnalisés et définis par le droit, de quelle reconnaissance ou sentiment d’appartenance étaient accompagnés des groupes et communautés plus informels, tels, entre autres, les romieux et jacquets cheminant vers leur destination ou revenus d’un même pèlerinage ?
Il y avait en tout cas diverses manières de faire corps en Occident au Moyen Âge et à l’Époque moderne, à différentes échelles : quels étaient alors les éléments permettant à un groupe de s’identifier comme corps, comme communauté – et ces deux termes étaient-ils équivalents ? Dans quelle mesure reprenait-on et déclinait-on la métaphore organiciste ? L’a-t-on parfois écartée en rejetant certains traits (hiérarchie, non-interchangeabilité des fonctions…) et dans ce cas, des modèles alternatifs ont-ils été proposés ?
On s’interrogera aussi sur la manière dont les différents corps se situaient et interagissaient, non sans conflits parfois, au sein de l’unique « corps du Christ » qu’était l’Église considérée dans sa totalité, et sur la façon de reconnaître et de gérer au sein des communautés particulières les tensions, les dissensus sinon les dissidences. L’on portera évidemment tout autant attention aux manifestations d’un « esprit de corps » et aux formes de solidarité qu’impliquait cette cohésion, avec ses différents champs d’application, matériels et spirituels. En corollaire, la force du collectif et la manière dont il limitait ou non l’expression d’aspirations et d’expériences individuelles ne manqueront pas d’être scrutées. Il faudra également considérer la dialectique entre l’exigence de durée et de stabilité, garantie de la permanence du corps, et les dynamiques et évolutions qui sont la caractéristique d’un corps vivant, autrement menacé de dépérissement.
À partir des XIe-XIIe siècles, « faire corps » prend une résonance nouvelle avec l’essor de la doctrine et de la piété eucharistiques ; les liens entre corps sacramentel et corps mystique sont redéfinis. Par la vue ou la manducation, l’eucharistie met aussi en jeu le corps charnel de chaque fidèle ; l’appartenance au corps ecclésial engage ainsi la personne du croyant jusque dans sa dimension physique. Au-delà de la vénération croissante dont fut entouré le Corpus Christi, on pourra s’interroger plus largement sur la discipline des corps : dans quelle mesure l’injonction de faire corps s’est-elle cristallisée ici et là dans des gestes, des attitudes, des tenues ou codes vestimentaires ?
Dans la géographie mentale et spirituelle de l’Occident médiéval, « faire corps » dépasse les frontières du monde visible. Les composantes du corps ecclésial se démultiplient : par la communion des saints, l’Église militante est reliée à l’Église triomphante, mais aussi et toujours plus à l’Église souffrante ou pénitente – les âmes du purgatoire. Des solidarités unissent ainsi les vivants et les morts, mais également les êtres humains et les anges. La perspective eschatologique, toujours présente, dessine une manière idéale et définitive de faire corps, au sein d’une cour céleste dont tous les membres seront enfin rassemblés.
En conjuguant ces approches, il sera sans doute possible de mieux comprendre la manière propre dont le christianisme a contribué à la formation de communautés concrètes ou virtuelles, au regard d’autres corps constitués et d’autres communautés – dont un même fidèle était aussi, le plus souvent, partie prenante.